(1) .biz parce que .com est déjà pris. Et puis biz cela sonne comme « faire la bise ». Le muikku et le nom d’un petit poisson qui vit dans les lacs glacés de Finlande comme par exemple celui de Kangasjarvi.
From www.muikku.biz
Le slam de l’ABF
Nous sommes à l’été 2007. Je suis à Rosny et je suis en train d’aider Pia à rédiger son mémoire. Tout d’un coup me vient en tête une petite comptine que je baptise tout de suite « le slam de l’ABF »:
Je suis A-U-E
et j’écris mon P-F-E
pour moi c’est tout bénef
oui je veux être A-B-F
et où ce que t’es s’t'AP ?
ben … au SDAP !
Secrets de famille surgis du passé
Cet été je me suis, encore une fois, rendu compte de la quantité d’évènements que nous enregistrons de façon incomplète dans les histoires de famille. Les pièces qui manquent à la compréhension n’attendent qu’une occasion pour sortir. Une conversation et la mémoire s’entrouvre.
Cristiana, la fiancée de mon cousin Luca, m’a rapporté une phrase qui a été dite par ma grand mère à ma tante Marta, la femme de mon oncle Valentino. Un jour, dans la conversation, ma grand mère maternelle, Pierina, à glissé ces mots: « Pour moi, coucher avec mon mari, c’était comme faire la vaisselle » Cette phrase est vraiment étonnante. Non seulement par le sujet abordé car je n’ai jamais connu ma grand mère que comme une femme âgée, bien sûr, mais aussi dévote et très secrète sur certaines choses. Mais en outre parce que ces mots sont à la fois un aveu et un conseil. Un aveu d’impuissance face à des règles sociales très codifiées et un conseil désabusé comme si cela était une tâche domestique qu’il fallait expédier. Le plus étonnant encore est l’acceptation de cette condition comme si l’essentiel était ailleurs.
Ma grand mère n’a jamais dit qu’elle aie été malheureuse dans son mariage. Elle l’a été terriblement lorsque son mari, mon grand père Giovanni, à été fusillé en 1944 pour acte de résistance et il a bien fallu, à partir de là et du jour au lendemain, apprendre à survivre avec tous les enfants, dont certains en bas âge… Seule.
Je rapproche ces nouvelles pièces qui ressortent du passé à d’autres qui me sont venu à l’oreille, hier, lors d’une conversation avec mon frère Alberto et qui m’a éclairé sur un autre fait resté dans l’ombre. Et là encore, c’est parce que ma mère l’a raconté à Anne l’amie de mon frère. Ce qui montre bien aussi que les confidences se font plus facilement entre femmes ou par leur intermédiaire. On constate dans les deux cas qu’il faut attendre que le fils fasse entrer une femme dans la famille pour que la mère commence à se confier.
Je m’étais toujours demandé quel attachement pouvait lier mon père à sa sœur aînée, tante Caterina. Tous les ans ma mère continue à fleurir la tombe de tante Caterina dans le cimetière délaissé de Portis. D’ailleurs encore cet été, je me suis installé à l’ombre dans la douceur du cimetière de Portis à contempler la montagne, tandis que ma mère, que j’avais juste accompagné en voiture et très contente que je ne la dérange pas, s’affairait auprès de plusieurs tombes, dont celle là.
Tante Caterina était l’aînée de la famille, mon père était le petit dernier. Il y avait d’ailleurs tellement de différence d’age qu’elle était née presque la même année que ma grand mère maternelle. Chaque année dans ce cimetière j’entends la même histoire, comme du temps où mon père venait aussi et qu’il me la racontait lui-même. Tante Caterina est morte en 1939 à l’âge de 33 ans d’une maladie de cœur. J’avais toujours été étonné que l’on puisse mourir si jeune de cette façon, mais mes questions me renvoyaient toujours à la fatalité.
Or ce que j’ai appris hier, c’est une autre histoire. Tante Caterina était en fait en pleine santé, bien faite et bien instruite puisque elle était même allée travailler à Rome, ce qui était rare pour l’époque. De retour au village, elle était tombée amoureuse d’un homme qui travaillait à la gare, la Stazione Carnia, qui a donné le nom au village justement.Ils devaient se marier. Mais, pour une raison encore non dite, cet homme est parti pour une autre femme. Elle en est morte. Et je m’imagine maintenant la douleur implacable de cette femme amoureuse… séduite… qui s’est laissée mourir de tristesse infinie. Et ce qu’on m’a toujours décrit, de façon détournée, comme une maladie de cœur était donc, en fait, un chagrin d’amour, qui est bien au sens figuré, une affaire de cœur. Moi, je crois tout à fait que l’on peut mourir d’un chagrin d’amour.
Levallois
LEVALLOIS
Ce matin du jeudi 10 juin 2004 je dois me lever très tôt. Hier j’ai donc mis mon réveil et pour plus de sécurité dans ces cas là je rajoute aussi la sonnerie de mon portable. Et à 6 heures du matin, tout ce joyeux petit monde se met à sonner. Je lutte contre le sommeil, le téléphone dans la main, le doigt sur le réveil pendant de long minutes. On ne change pas ses habitudes de se lever à midi tous les jours comme ça. Et la lutte dure pendant une heure presque. Je fini par me lever et me préparer.
Je dois aller à Levallois pour un séminaire Fluke sur l’analyse de réseaux informatiques. Cela fait des mois que je m’y suis inscrit. La date du 10 juin me paraissait lointaine à l’époque mais elle a bien entendu, comme toute chose, fini par arriver. J’ai accepté ce séminaire d’une demi journée pour plusieurs raisons. Premièrement, il est gratuit. Ensuite Fluke, cela me rappelle des souvenirs. C’est un constructeur de testeurs électriques et j’en avais un dans ma valise de maintenance informatique, autrefois. C’était tellement courant que le mot était passé dans le langage courant, un peu comme Frigidaire. Et puis, Levallois aussi me rappelle des souvenirs. J’y ai travaillé il y a très longtemps tout au début de ma carrière de technicien de maintenance sur ordinateur.
Parce que j’ai peur d’avoir faim et de ne pas bien écouter, je mange quelques tartines de pain sans gluten à la confiture de mûres. Ceci, bien que je me dise que tout à l’heure j’aurais peut-être droit aux croissants. Aurais le temps d’aller à Levallois en voiture? Je voulais partir tôt exprès. Je décide de prendre le train. Je prends rarement le métro maintenant depuis que je suis au chômage. Et me voilà parti sous la canicule qui commence à s’installer avec un tee-shirt, mon sac à dos de cuir tanné et mes baskets à 8 euros de chez Lidl. Il est 7h30.
Je pars d’Igny et je gare ma voiture dans une rue proche de la gare de Massy Palaiseau ou’ j’achète un aller retour pour Paris. 5 euros. Pour ce prix là, on peut manger un repas. Quand j’arrive sur le quai je n’ai pas le temps de regarder à quelle gare je dois descendre et je prends le direct qui arrive en prenant le risque de descendre à Denfer Rochereau. Ce trajet j’ai du le faire un millier de fois, surtout pour aller travailler ces dernières années. C’est d’ailleurs l’illusion que je me fais en regardant les rayons de soleil jouer au fenêtres. Je me souviens de mes petites angoisses du matin, quand le devoir m’attendait et de mes petites joies du soir, quand le devoir était accompli. Parfois c’était carrément de grosses angoisses. Mais aujourd’hui je suis serein. Cela me rappelle justement la période Levallois. Jeune technicien bien payé et plein d’avenir.
A Denfer je me rend compte que j’aurais mieux fait de continuer jusqu’aux Halles. Le train suivant nous suivant de près, je n’ai pas perdu beaucoup de temps. Je ne peux pas faire mieux que deux changements, aux Halles et à Opéra. Je ne sais pourquoi les solutions à deux changements, ou plus, me déplaisent. Non pas parce que il faut marcher, mais parce qu’elles ne me paraisse pas efficaces. Et puis la gare de Opera-Auber-St Lazare depuis la nouvelle ligne E est devenu tentaculaire. Je descend à Anatole France. C’est une station que j’ai fréquenté un peu seulement, car en fait à Levallois je venais travailler en voiture. Je suis descendu une station trop tôt, mais je ne suis pas en retard et je vais marcher un peu. Je demande mon chemin avant de me rendre compte que j’ai le plan imprimé dans ma poche.
Il est quand même 9h10 quand j’arrive à l’hôtel Evergreen où a lieu le séminaire et où je m’attend à trouver une foule. L’hôtel est cossu et renseignement pris, le séminaire est relégué dans un petit salon du 1er étage. Dans l’ascenseur je croise un riche vacancier en short. Au moins je ne dépareille pas. A l’étage au fond d’un couloir je suis accueilli par la classique petite troupe en bras de chemise, des intervenants en cravate et la table au café et aux croissants. Normalement je ne dois pas manger de croissants, mais par réflexe j’ai prends quand même un pour ne pas vexer la personne qui m’y convie. Enfin, c’est ce que je me dis. Je n’en veux pas mais je le mange tellement vite que j’ai l’air d’un pique assiette. Ceci fait, je prends mon badge et je vais prendre place au premier rang dans la petite salle d’une centaine de chaises. En général je n’ai pas de demi mesure. C’est soit le dernier rang si je rentre dans une assemblée un peu par hasard et que je ne veux pas m’impliquer mais je m’assoie au premier rang si j’ai décider que la réunion doit m’intéresser. Et je suis là pour apprendre.
Dans le fond de la salle à l’arrière il y a du matériel en libre service et sur le devant l’incontournable retro projecteur. Il semble que cela va commencer plutôt vers 9h30. Je n’étais donc pas du tout en retard, mais malgré tout je m’inquiète si l’on aura du temps pour faire quelque chose en une seule matinée. Mais je suis indulgent car je me rappelle de mes angoisses lorsque, moi même, je devais donner des cours et faire donc des présentations. Le temps au contraire me paraissait toujours trop long. Il fallait que je parle, seul, pendant 5 jours tout en gardant un contenu digne d’intérêt. Et là, après tout, il ne s’agit que d’une demi journée. Sur ma chaise j’ai trouvé de la documentation, un bloc note et un très beau stylo, consistant en main.
La moitié des chaises sont vides lorsque la présentation commence et les intervenants se succèdent dans une chorégraphie simple et plaisante. J’apprends que Fluke faisait des testeurs d’électricité depuis 1949 et qu’en 1993 la société a décidé de se lancer sur le marché de l’analyse de réseaux. Les présentations techniques suivent les présentation marketing et je suis tout content de voir que même après un an et demi d’inactivité je comprends très bien tout ce qui se dit. Là aussi des flash back me reviennent où se mélangent l’acquisition à marche forcée de connaissances pointues sur les réseaux qui datent des 5 années de cours que j’ai donné, il n’y a pas si longtemps, avec ces périodes lointaines et un peu folles où, beaucoup plus jeune, je hantais les salles blanches, traquant le dysfonctionnement informatique juste à l’intuition mais avec un joyeux succès. Je me dis que l’un dans l’autre j’aimerai bien revivre l’un et l’autre en même temps dans un job d’ingénieur réseaux, aujourd’hui.
Ceci n’est pas très compatible avec ce que j’ai dit depuis un an à l’anpe à savoir que je désire développer une interface graphique révolutionnaire et que donc j’ai besoin maintenant d’une formation de développeur. C’est vrai, les deux choses me plaisent tout autant. Comme celle de ne pas travailler du tout, du reste. Et passer ma vie à écrire. Peut-on faire tout ce que l’on veux en même temps ou bien une chose après l’autre? La réponse est évidente. Pour l’instant dans mes souvenir de technicien, je tiens dans mes mains des instruments que j’aimerais bien utiliser parce que cela me plairait et que cela me rapporterait de l’argent facilement. Mais, au fait combien coûte chacun de ces joujoux? Entre 10.000 et 30.000 euros. Bon, effectivement il faudrait bien rentabiliser l’investissement même pour une société et je ne parle pas d’un particulier comme moi, qui voudrait lancer son activité.
Je quitte d’un pas calme l’hôtel en me rejouant dans le tête la manière imperturbable avec laquelle j’ai l’habitude d’accueillir les propositions chiffrées les plus folles lorsque je ne suis pas obligé d’acheter. Je me demande toujours qu’elle impression j’ai du laisser à mon interlocuteur. Je me dis que je dois le conforter dans son idée que ce n’ai vraiment pas cher où alors que je suis vraiment très riche. Je pense que ce doit être tout à fait l’impression laissée par un émir du pétrole que l’on croise dans une bijouterie de la place vendôme.
En revenant au rez-de-chaussée je me rend compte d’ailleurs que la clientèle de l’hôtel est plutôt étrangère. Riche et étrangère. Sur le rack il n’y a que trois journaux emmanchés d’un bois. L’un est japonais l’autre coréen et sur le troisième je crois reconnaître de l’écriture tamoul. Je quitte cette opulence pour retrouver la pauvreté de la rue. En fait de pauvreté Levallois n’est plus ce qu’elle était. Je me souviens des rues grises. Mais aujourd’hui elle a été gagnée par la fièvre de Paris tout proche. Le quartier de l’hôtel où je suis est tout neuf. Un peu trop d’ailleurs. La pierre reconstituée est trop propre. Je remarque bien quelques immeubles anciens aux façades certes ravalées mais architecturalement élaborées. Rien à voir avec le carcan de nouveaux bâtiments qui, à l’évidence, ont du subir une coupe budgétaire sur la ligne de crédit destinée au charme. Je dirais la même chose de ces nombreuses terrasses de restaurant qui a cette heure-ci sont bondées d’abonnés au ticket restaurant. De plus ici les rues sont tracées au cordeau et le long des ces élévations sans âme, la recherche de l’ombre devient un problème. Il y a bien quelques arbres, mais ils sont jeunes et disposés comme dans une maquette grandeur nature plutôt pour remplir un espace que pour y apporter la vie.
Je prends la direction de la rue Camille Pelletan ou’ j’ai travaillé autrefois. Le numéro de la rue m’importe peu j’ai du temps devant moi pour me promener. Chemin faisant j’essaye de reconnaître quelques détails, comme une boutique ou un bar qui m’évoquerait des souvenirs. Mais rien, tout ici à l’air rénové. Un instant j’ai même peur que l’immeuble que je cherche a pu être purement et simplement rasé, au train ou’ sont allées les choses dans cette banlieue si proche de la capitale. Car c’était tout de même il y a presque 25 ans!
La rue n’est pas très longue et je repère vite la silhouette familière de ce qui a abrité autrefois le centre de maintenance de Prime computer. Je me souviens même du numéro maintenant le 34/38. Le bâtiment à été rhabillé. La brique rose a remplacé les petits carreaux blancs. La peinture verte est venue recouvrir le métal gris de la superstructure de façade arrondie, mais le bâtiment est bien là. Je regarde distraitement la liste des sociétés aujourd’hui présentes pour chercher une familiarité car le hall d’entrée ne m’évoque rien. Je ne me rappelle même pas de l’étage et pourtant l’immeuble n’est pas bien haut. Il est vrai que nous entrions et sortions toujours en voiture par le parking. Lui, son entrée je la reconnais…
Prime computer n’était pas la première société pour laquelle j’ai travaillé. Mais les premiers mois durant ce printemps 1980 ont été des mois de grandes découvertes et de grandes libertés. Mon salaire faisait un bond de 4300 F à 5200 F. Une petite fortune pour moi qui venait de m’installer dans mon nouvel appartement à Igny. De plus on nous donnait une voiture de fonction. Une R5, avec une banquette arrière, une vrai voiture. Quand j’ai raconté tout cela à ma mère, elle m’a dit de me méfier car c’était trop beau. En sillonnant Paris en voiture pour me rendre chez les clients j’ai appris à connaître la ville dont à l’époque je ne connaissais que le quartier St Michel, car Luxembourg a longtemps été, jusqu’en 1978, le terminus de la ligne de train qui m’amenait d’Antony ou’ j’habitais chez mes parents.
Avec cette voiture de fonction, je revenais là, à cette entrée de parking, une fois le travail terminé, pour repartir ensuite vers d’autres clients. Je me souviens du mode fermeture de la porte qui obligeait à ne pas trop s’en approcher et des cartes magnétiques qu’on m’avait appris à copier avec des petits bouts de lames de rasoir incrustées. C’est de cette porte aussi que je suis parti en novembre de cette année là au volant de la voiture de notre directeur technique qui me l’avait prêtée pour les vacances. Mon copain John voulait une grosse voiture pour partir en vacances. C’était une R18 verte et bonne pour la casse. Nous nous en sommes rendu compte après que le cardan se soit cassé à notre arrivée au Friul en Italie. Tout notre argent des vacances est passé dans la réparation. On a fini les vacances en mangeant des sandwichs. A mon retour j’ai bien entendu été remboursé et j’ai remis ici la voiture dans ce garage.
Notre directeur technique était sympathique. C’était lui qui m’avait embauché. C’est dans ce garage que je l’ai vu aussi pour la dernière fois. Il venait de de faire licencier pour désaccord dans la politique à mener. Je l’ai croisais, là en bas, entre deux clients. Je n’ai pas compris tout de suite la solennité du moment. Il voulait me dire au revoir et combien il m’appréciait et moi dans mon empressement de jeunesse je pensais seulement à partir chez mon prochain client. Je pensais peut-être lui montrer avec quel sérieux je travaillais, mais avec le recul je pense que j’aurais du au contraire trouver autre chose que des propos de circonstance. « Tu as l’air tellement sérieux » me dit-il et puis il a ajouté, « cela doit plaire aux filles ». J’étais flatté, mais je ne pouvais malheureusement rien lui confirmer. En fait, il voulait tout simplement me débaucher pour m’emmener avec lui dans sa nouvelle structure… mais je suis quelqu’un de fidèle, et j’ai décliné Je me suis souvent demandé quelle aurait été ma vie si je l’avais écouté… Meilleure peut-être, après tout…
Je décide de continuer dans la rue et prendre la direction de la cafétéria casino qui devait se trouver à Clichy, de l’autre coté du pont de chemin de fer. Je me rappelle que nous remplissions plusieurs voitures et que nous y allions déjeuner dans les premières semaines de mon arrivée ici. C’était les toutes premières fois que j’allais au restaurant en ville. Dans mon précédent emploi il y avait un restaurant d’entreprise. Ces rituels de déjeuner étaient bien évidemment destiner à souder toute l’équipe, mais moi je n’arrivais pas a participer à ces conversations où l’on parle de tout et de rien mais surtout de boulot. Et moi, du boulot je n’en avais pas beaucoup d’expérience. Je mangeais donc très mal à l’aise. J’ai apprécié par contre plus tard lorsque je déjeunais librement au gré de mes interventions un peu partout et à toute heure de la journée.
Je passe sous le pont et arrivé à Clichy je demande quand même mon chemin. J’ai de la chance on m’indique la rue suivante, la rue Martre. Je la connais pourtant bien c’était la rue d’un de mes clients, l’immeuble mauve de l’Oréal. Je le vois d’ailleurs. C’était donc la même rue alors, mais le bâtiment que je cherche moi est en travaux. En m’approchant je vois juste la marque de l’immense inscription lumineuse, cafétéria, qui est maintenant enlevée. Je rentre pour constater que c’est juste un super marché Casino. On m’apprend que la cafétéria a fermé il y a un en et demi. Dommage pour le souvenir, mais j’ai faim parce qu’il est déjà une heure passée.
Juste à coté j’avise un turc. Depuis mon récent voyage à Istanbul je remarque les doner kababs. Va pour une assiette de viande frites salade à 6 euros, car depuis longtemps je ne fais plus parti du monde des tickets restaurant. De l’échoppe minuscule on m’indique le bistrot d’a coté typiquement parisien où je dois aller m’installer au fond. Je suis amusé par cet étrange mariage entre ces deux activités. J’ai déjà vu des crêpiers dans ce cas là, mais des turcs, c’est la première fois. Une dame, France profonde, vient calmement pour prendre la commande. Je ne veux que de l’eau et puis je me ravise. Je vais finalement prendre une bière. Il fait chaud et tant pis pour si peu de gluten. Derrière le comptoir l’homme qui garde la caisse est en intense discussion dans une langue que je pense être du turc.
Dans mon village au Friul la patronne d’un des bistrots ainsi que le patron de l’autre bistrot sont décédés. Cet été avec mes cousins on s’était amusé à pensé qu’en fin de compte il aurait été peut-être intéressant pour les deux survivants de se mettre ensemble. Je m’invente, ici donc, une histoire qui est sans doute vraie. La patronne de ce bistrot, restée veuve, s’est mariée avec le turc qui avait l’échoppe d’a coté et que ses fils font maintenant marcher. Mais à ce détail près ce bar manque vraiment de charme et une fois repu, je me lève. A la caisse le patron me tutoie, je souris. Dehors sur le pas de la porte, la bouche de métro de Clichy m’attends. Non je ne vais pas aller me promener sur Paris comme je l’avais envisagé. Je vais rentrer directement chez moi. Soyons sérieux, il faut que je cherche du travail. Mais dans quel secteur? Les réseaux informatique ou bien l’écriture de nouvelles?
La fille de Picasso
Entendu dans une émission sur Picasso sur la chaine Planète.
C’est la fille de Picasso qui s’exprime.
Au début de chaque année scolaire, nous devions comme d’habitude remplir une fiche où nous devions indiquer le nom du père et sa profession. J’écrivais bien entendu…
nom: « Picasso », profession: « Peintre ».
Et là, invariablement, on me demandait: « Peintre en bâtiment? »
Et je répondais: « Oui ».
Comme ça on me fichait la paix jusqu’à la fin de l’année…
Lorsque j’avais des devoirs à faire à la maison, et que je ne pouvais pas toujours tout faire, si j’avais une dissertation et un dessin à faire, par exemple, je faisais la dissertation et je demandais à mon père de faire le dessin.
Un jour il y avait un abat jour à dessiner. Mon père l’a dessiné. Moi je l’aimais bien. On voyait bien la forme de l’abat jour mais il avait dessiné une décoration, de l’abat jour, à sa façon.
Lorsque j’ai ramené le dessin à l’école le professeur l’a regardé et ma dit: « Mais ça ne ressemble à rien!… A’ refaire! »
Et mon père a refait le dessin.
Fubuki
Hier je suis allé, à Paris, voir le film « Stupeur et tremblement » tiré du livre d’Amélie Nothomb, du même nom. J’ai été déçu parce que le film… est très bien. Ce qui est rare lorsqu’un film est tiré d’un livre. Il est très fidèle au livre et le relègue malheureusement au rang de script. Je me suis donc fait l’effet d’un réalisateur regardant la dernière mouture de son montage qui lui est désormais familière. Il faut dire que le livre s’y prête bien, puisque déjà dans son style il a été écrit pour être raconté et donc filmé.
D’ailleurs dans la salle, grande et pleine, on se rendait bien compte qu’il y avait deux genres de public. Ceux qui n’avaient pas lu le livre et qui riait aux éclats à chaque situation cocasse. Je rappelle, tout de même, que j’étais dans une salle UGC du quartier des Halles. Et puis il y avait ceux qui avaient lu le livre. A mon avis, la grande majorité de la salle. Eux ne manifestaient rien. De la même manière que je revoyais, à l’écran, des images que je m’étais déjà faites dans la tête, en lisant le livre, je les suspecte d’avoir eu le même regard convenu et complice que le mien.
Le film et le livre sont-ils une caricature du monde du travail au Japon? La réponse est bien évidemment: non. Ce n’est pas une caricature, c’est la réalité. C’est la réalité comme seul un étranger peut la voir. Ceci dit, peut-on sérieusement faire un quelconque parallèle avec le monde du travail en France? La réponse est bien évidemment: oui. Autant le japonais introverti subit-il l’humiliation ouverte et théâtrale de ses collaborateurs, autant le français extraverti subit-il l’humiliation subtile et cachée de ses collaborateurs. La raison en est la même. S’imposer pour que l’on ne s’impose pas à vous.
C’est donc bien la peur qui est, comme trop souvent, le moteur du système. Cette règle dépasse bien entendu le cadre du monde du travail qui n’est, dans ce cas, qu’un générateur de rencontres. Cette peur, a tout simplement pour conséquence, l’inversion des valeurs. La bonne intention devient la mauvaise intention. L’attention particulière et sincère que l’on porte aux autres est interprétée comme une tentative d’invasion et de prise de contrôle. C’est ce que j’appellerais le syndrome Fubuki.
giorgio
Retrouvez mes chroniques dans les parutions des Éditions du Shqiptar
Rue Varlin
Lettre ouverte à Monika.
Le 20 janvier vers 10h du soir, rue Varlin, il y a eu un grand bruit. Si tu avais été là, quai de Valmy, tu l’aurais peut-être entendu. Je me rendais au chevet de l’ordinateur de Suzel, lorsque dans la rue je lève les yeux pour voir s’il y a de la lumière chez toi et… j’ai tamponné la voiture qui était devant moi. Aucun dégât. Mais en 25 ans de permis ce doit être l’une des rares fois où je ne regarde pas où je vais. Quelque chose comme le type qui regarde une fille passer et qui se tape le réverbère sur le trottoir.
giorgio 22 01 2003
Web Cam Marseille
 Aujourd’hui Alberto m’appelle comme il le fait souvent quand il en vadrouille avec une de ses conquêtes. Il est à Marseille. Je le garde en ligne et je me dépêche discrètement sur internet pour trouver une web cam. Il me dit qu’il est sur le port au pied d’une tour. Je connais l’endroit pour y être passé justement il y a peu, en début d’année 2002. Je voudrais bien lui faire une surprise, mais malheureusement le rafraichissement incertain de l’image ne me permet pas de lui dire que je le vois…
Aujourd’hui Alberto m’appelle comme il le fait souvent quand il en vadrouille avec une de ses conquêtes. Il est à Marseille. Je le garde en ligne et je me dépêche discrètement sur internet pour trouver une web cam. Il me dit qu’il est sur le port au pied d’une tour. Je connais l’endroit pour y être passé justement il y a peu, en début d’année 2002. Je voudrais bien lui faire une surprise, mais malheureusement le rafraichissement incertain de l’image ne me permet pas de lui dire que je le vois…
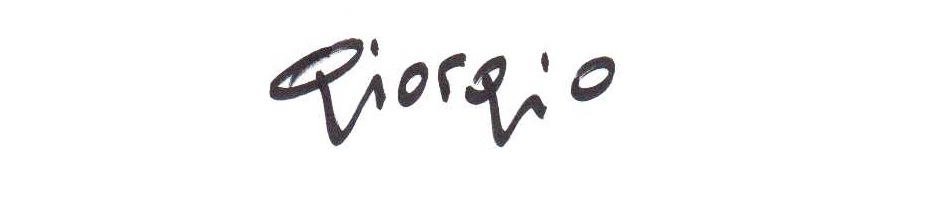
 Français
Français Furlan
Furlan Italiano
Italiano English
English Deutsch
Deutsch Suomi
Suomi Shqip
Shqip Pular
Pular